L’année 2020 restera marquée d’une tache noire. Après une crise sanitaire inédite, s’en est suivie une crise économique d’ampleur. Soutenues par les mesures étatiques, les entreprises ont pour la plupart passé la vague. Mais 2021 s’annonce encore plus compliquée. Quels réflexes doit adopter le dirigeant pour faire face à la réalité ? Quelles décisions prendre face à des signaux financiers inquiétants ? Et surtout, à quel moment ?
Propos recueillis par Lucy letellier et ONDINE Delaunay.
Avec : Julien Zuccarelli, President YesnYou, Président du directoire de la société Abilways, Albert Szulman, Fondateur de ScaleUp Booster, Caroline Texier, Avocate Associée, DLA Piper, Numa Rengot, Avocat associé, Franklin, Charles Beigbeder, Entrepreneur et investisseur, Aline Poncelet, Avocate associée, HFW, Noam Ankri, avocat associé, Ashurst, Nicolas Yakoubowitch, Associé, Exponens.
Concilier vitesse, courage et collectif
Charles Beigbeder, entrepreneur et investisseur : La crise sanitaire a été un choc pour tout le monde. Elle nous a poussé à réfléchir à nos entreprises pour tirer parti de cette situation inédite. Je dirige Audacia qui est une entreprise d’investissement. Durant le premier confinement, nous étions quasiment tous en télétravail. Rapidement, nous avons pensé que c’était le moment d’accélérer nos démarches de numérisation. Nous sommes passés au 100 % en ligne. Nous avons également profité de cette période pour lancer de nouveaux fonds. La période a donc été fructueuse à cet égard.
Depuis fin août, la situation est bien différente et l’inertie importante. La crise sanitaire tétanise les acteurs de l’investissement et les épargnants. Je suis donc dans une phase où je réfléchis à comment faire réagir les détenteurs de capitaux, qui sont des particuliers fortunés, des family offices et quelques institutionnels. Car si le ralentissement continue, nous risquons d’avoir un problème de top line. Il faudra alors réfléchir à faire entrer de nouveaux investisseurs à notre capital. C’est un discours que je tiens toujours aux entrepreneurs, peut-être qu’il faudrait également que je me l’applique à moi-même pour avoir plus de moyens afin d’abonder dans les fonds que nous lançons et créer ainsi une dynamique positive.

[ Charles Beigbeder - « La crise sanitaire tétanise les acteurs de l’investissement et les épargnants. »
Julien Zuccarelli, président YesnYou, président du directoire de la société Abilways : Je préside deux entreprises de formation, YesnYou et Abilways, qui sont toutes les deux confrontées à des problématiques de retournement antérieures à la crise Covid. Au moment où l’épidémie est survenue, nous avions déjà franchi plusieurs étapes de retournement. J’ai une vingtaine d’années d’expérience de direction générale dans des entreprises de technologie ou de formation et je peux témoigner qu’on ne se dépiste jamais assez tôt. Le dirigeant regrette toujours de ne pas avoir vu plus tôt un certain nombre de signaux, de ne pas avoir pris des décisions plus rapidement. On a tous la tentation de se dire que dans trois semaines, dans quinze jours, notre choix sera éclairé par plus d’informations, plus d’analyse. Dans 99 % des cas, un mois plus tard, rien n’a changé et la prise de décision se fait à l’aune des mêmes informations. On a juste perdu un mois.
Dans une phase de crise, le dirigeant doit être courageux car il a des choix difficiles à faire. Sa vitesse de réaction et de décision est capitale. Il doit accepter l’idée de faire des erreurs. Il est aussi important de raisonner collectivement car dans des périodes de difficulté, l’entreprise est pleine de bonnes âmes qui de façon bien attentionnée vont essayer de sauver la patrie toute seule. Il faut donc concilier la vitesse, le courage et le collectif.
Albert Szulman, fondateur de ScaleUp Booster : Je connais assez bien l’univers des start-ups pour avoir fondé plusieurs start-ups avant de cofonder ScaleUp Booster qui est un accélérateur de start-up à l’international. Je suis par ailleurs membre du mouvement Les Rebondisseurs français, ce qui me permet d’avoir plusieurs lectures de la situation économique actuelle. Je pense qu’une bonne partie de ceux qui sont tombés étaient déjà fragiles. Je ne vise bien sûr pas les secteurs stoppés du jour au lendemain, comme l’évènementiel par exemple. Mais les crises révèlent rapidement les faiblesses. Or si, grâce à BPI France, l’écosystème des start-ups est bien soutenu, en particulier en « early stage », cela ne doit pas faire oublier aux entrepreneurs que la gestion des flux financiers est essentielle, à commencer par la génération de chiffre d’affaire, et donc de marge. Et ce soutien financier a sans doute engendré une mauvaise perception de certains dirigeants de start-ups sur la priorité qui doit être, comme toute entreprise, de devenir rapidement autonome, donc de gagner de l’argent pour financer ses dépenses.
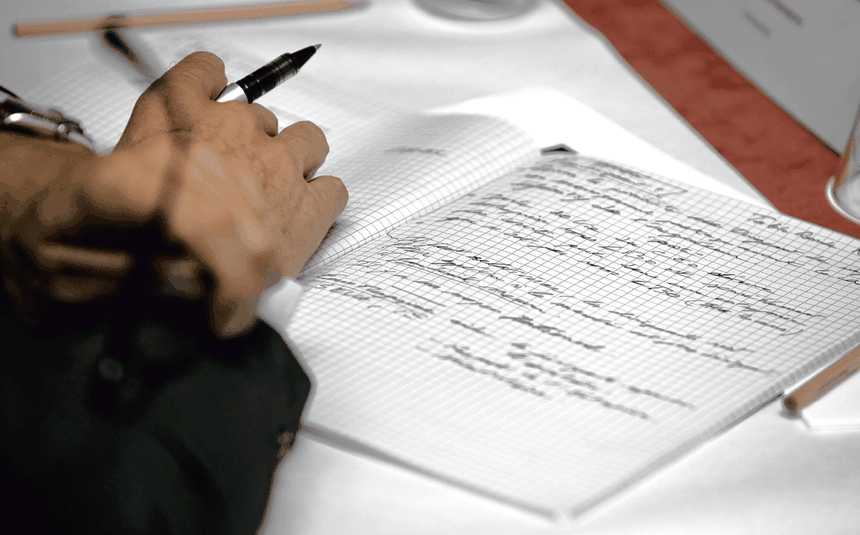
Selon une enquête de la CPME, 47% des dirigeants estiment que la pérennité de leur entreprise est potentiellement menacée pour le second semestre 2020.
Julien Zuccarelli : Je suis toujours frappé de constater qu’on ne dépiste jamais suffisamment l’insuffisance de la top line. Des problématiques industrielles sont mises en avant, des problèmes d’organisation, etc. Mais la réalité, c’est qu’il n’y a plus de chiffre d’affaires. Or l’un des devoirs du chef d’entreprise c’est d’être vigilant sur sa top line, car c’est là que le bât blesse assez souvent.
Être à l’écoute des signaux faibles
Albert Szulman : Au sein du mouvement Les Rebondisseurs français, nous recevons un certain nombre de dirigeants qui soit ont vécu des situations difficiles, soit n’ont pas vu venir les crises internes ou externes qui les ont fait tomber. La plupart des entrepreneurs apprennent la dureté de la chute, souvent seuls, et c’est aussi contre cela que nous nous battons. La première chose que nous leur communiquons c’est d’accepter l’échec qui ne doit pas être vécu comme une honte, mais comme une première marche de l’escalier de la réussite. C’est grâce à l’échec que l’on apprend, et c’est avec ce que l’on a appris que l’on gagne en efficacité. C’est évidemment difficile à digérer lorsque l’on vient de chuter, mais être entouré d’autres entrepreneurs qui sont passés par là aide à relativiser, à repartir plus vite.
Il est très important pour un entrepreneur d’écouter les signaux faibles. Bien souvent, les entrepreneurs sont considérés des surhommes et par conséquent s’interdisent toute erreur. Ils ont donc souvent beaucoup de mal à communiquer sur leurs problèmes, à trouver des interlocuteurs qui puissent les aider à réfléchir aux mesures à prendre, avant qu’il soit trop tard. Et c’est toujours trop tard. Malheureusement, ils n’écoutent pas les signaux faibles en pensant qu’il est normal que tout ne soit pas parfait au début. Mais ces signaux faibles, ce sont les annonces des catastrophes à venir. Chaque seconde compte, même si moralement ou éthiquement c’est difficile. Il faut aider les entrepreneurs à se libérer de cette charge émotionnelle pour qu’ils prennent les bonnes décisions.
Aline Poncelet, associée, cabinet HFW : Les difficultés sont en effet généralement perceptibles depuis bien longtemps. Les signaux peuvent être des signaux forts. Une affaire, titrée dans la presse « L’électrochoc de l’affaire Nasa », avait jeté la panique sur la place de Paris parce que les dirigeants et administrateurs avaient été poursuivis en tant que fondateurs. Les juges ont considéré que la société avait été constituée dès le début sur le fondement d’un business plan et d’un plan de financement non viables, les ratios financiers fondamentaux et l’équilibre fonds propres/ dettes n’étant pas déraisonnable.

[ Aline Poncelet - « L’importance d’écouter les signaux faibles c’est aussi de réagir le plus tôt possible pour garder le contrôle sur la restructuration nécessaire. »
Les signaux faibles sont quant à eux souvent éludés. Les alertes des commissaires aux comptes ou celles prévues par le droit des sociétés contre la sous-capitalisation sont négligées Ce qui intéresse les dirigeants, c’est de savoir qu’ils ont encore deux ans devant eux, qu’ils n’auront pas de sanction en pratique. Voire ils peuvent faire du forum shopping et changer leur siège social de localité car certains tribunaux ont des délais de réaction plus longs. Le déploiement du projet « signaux faibles » par le Ministère de l’Économie à l’heure actuelle vise à accélérer la détection et donc la prévention. À court terme.
J’ajouterais des signaux juridiques insidieux et trop sous-estimés comme les conflits d’actionnaires ou les contentieux lourds. Ne pas les résoudre de manière transactionnelle peut s’avérer « mortel » au bout de quelques années.
Noam Ankri, associé, cabinet Ashurst : Dans les grandes sociétés ayant une dette sous forme de financement structuré, le calcul régulier, voire bien sûr la rupture des covenants, constitue un autre signal d’alerte, qui permet de réaliser si la société va aller moins bien dans les prochains mois. Dans les opérations large cap, il est fréquent que les documentations rédigées soient « covenant lite » c’est-à-dire avec très peu de covenants financiers ou des périodes de calcul très espacées. Bien sûr, le dirigeant et le directeur financier s’en réjouissent car c’est moins contraignant, notamment en termes de reporting, mais d’un autre côté, c’est un signal d’alerte qui disparaît. Or, le levier de dette par rapport à l’Ebitda est, selon moi, un indicateur essentiel. Lorsqu’il approche les 6, voire les 7, la zone est déjà très dangereuse et implique de prendre des mesures d’urgence, le cas échéant d’ouvrir un mandat ad hoc ou une conciliation.
Nicolas Yakoubowitch, associé, Exponens : La principale caractéristique d’un entrepreneur c’est d’être optimiste, et d’avoir une certaine dose d’inconscience pour créer un business dans ce pays qui est extrêmement réglementé. D’où l’intérêt d’être bien épaulé par un expert de la comptabilité qui insistera sur une réaction immédiate des dirigeants à ces signaux rouges.
Rappelons que l’entreprise passe en état de cessation des paiements quand elle n’a plus la capacité de payer son passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire sa trésorerie. La ligne rouge à ne pas franchir c’est un délai de 45 jours qui suit cet état de cessation des paiements. À partir de là, s’ouvre une procédure collective – un redressement judiciaire ou une liquidation – qui peut conduire à des sanctions personnelles à l’encontre du dirigeant ayant tiré la sonnette d’alarme un peu tard. Pour éviter cette situation, on a recours à des mesures préventives, domaine dans lequel j’ai une activité assez intense à Versailles travaillant avec les auxiliaires de justice et le tribunal de commerce notamment.
Or aujourd’hui, les statistiques du tribunal de commerce de Versailles sont à -60 % d’activité en préventif par rapport à l’année passée. Et pourtant les mandataires recrutent, car demain, quand la fin de la récréation sera sifflée, il y aura une cohorte de patients à la porte du tribunal pour déclarer un état de cessation des paiements. L’économie est actuellement totalement sous perfusion. Bien sûr, c’était indispensable et l’exécutif a tenu compte des erreurs de 2008 pour mieux réagir. Mais la mise en place du chômage partiel, le décalage du paiement des charges sociales, l’abondement d’un dispositif de financement des entreprises de type PGE, prêt rebond, fond résilient, ont surtout permis d’éliminer le problème du court terme. Jusqu’au jour où l’élastique va casser.
Le dirigeant doit donc tenir un discours de vérité, appeler ses conseils pour présenter la situation et demander de l’aide. Car des mesures de prévention existent : le mandat ad hoc ou la conciliation. Les deux procédures interviennent à des moments différents. Pour le mandat ad hoc, l’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements. Pour la conciliation, l’entreprise peut être en état de cessation des paiements mais depuis moins de 45 jours. On revient à cette fameuse ligne rouge de délai.

[ Albert Szulman - « La première chose que nous leur communiquons c’est d’accepter l’échec qui ne doit pas être vécu comme une honte, mais comme une première marche de l’escalier de la réussite. »
Julien Zuccarell : Quand la crise du Covid est survenue, YesnYou était déjà en conciliation. Je suis persuadé que le droit français fournit aujourd’hui tout l’arsenal dont les dirigeants ont besoin. Le mandat et la conciliation sont deux instruments que l’on peut utiliser très intelligemment. Ils ne répondent pas à toutes les situations, par exemple pour la société Abilways, je ne peux pas les utiliser. Mais ils ont été extrêmement efficaces pour YesnYou : nous sommes à 9 % d’Ebitda sur 2020.
Nicolas Yakoubowitch : Il faut agir quand c’est possible et faire appel à un auxiliaire de justice qui prendra une casquette de négociateur en chef pour le compte de l’entreprise. Il a l’habitude de parler avec les banques, avec les organismes sociaux et fiscaux pour permettre à l’entreprise de retrouver une ligne de crédit, c’est-à-dire en décalant dans le temps son passif.
Le revers de la médaille de tous ces dispositifs de soutien étatique, c’est que certaines entreprises qui auraient pu être placées en conciliation avant la crise sanitaire de mars, se retrouveront après directement chez le mandataire judiciaire sans passer par la case administrateur.
Réagir avant d’être en face du mur
Numa Rengot, associé, cabinet Franklin : Je crois pour ma part qu’il y a eu une forme de réalisme des chefs d’entreprise. Nous avons utilisé les procédures amiables pour traiter les difficultés de certains clients de façon très rapide. Nous avons mené quatre procédures amiables durant cette période pour des entreprises comptant entre 150 et 1600 salariés et avons réglé les difficultés en sécurisant l’ensemble des co-contractants. Ces dirigeants ont pris conscience des difficultés très en amont.
Le monde a changé en très peu de temps et l’on ne parle pas assez de cette période incroyable en termes d’opportunités.
À une certaine époque, l’investissement dans des entreprises en difficultés ou leur cession judiciaire étaient réservées aux professionnels du retournement. Aujourd’hui, nombre d’investisseurs et de fonds de la place sont en train de regarder ces cibles qui ont une forme d’attraction car elles ne sont pas irrémédiablement compromises. Parfois, ils font même le choix de se positionner en mode cession judiciaire alors qu’il y a encore un an pour ces acteurs il n’était même pas question d’y penser.
Je connais bien le secteur de la communication et des médias. Dans l’imprimerie par exemple, il y a énormément d’opportunités de croissance externe, en amiable et en judiciaire, pour préserver la filière et l’emploi. Or ce sont des acteurs qui n’étaient pas à l’origine éduqués au restructuring et ne pensaient pas qu’il était sécurisant d’investir dans une entreprise en sauvegarde, ou de faire un pré-pack cession. Je pense que nous aurons des statistiques différentes l’année prochaine, avec des typologies d’acteurs suprenantes. Peut-être que cette crise a permis de faire sortir ces dossiers par le haut alors qu’en temps habituel, ils seraient allés directement à la casse.

[ Numa Rengot - « Dans cette période, ce que j’appelle « l’amiable défensif » n’a pas toujours plus à certains administrateurs judiciaires qui considèrent avant tout la conciliation comme une mesure « consensuelle » d’accompagnement de la société. »
Charles Beigbeder : Nous aimons regarder les situations atypiques, mais nous n’avons pas de véhicule d’investissement dédié à ces opportunités. On y réfléchit car les évolutions réglementaires sont intéressantes. La société en difficulté peut désormais être reprise par ses propres actionnaires lorsque cela va dans le sens de l’intérêt social. Audacia pourrait se doter d’un tel fonds de retournement.
Caroline Texier, associée, cabinet DLA Piper : Les dirigeants ont su s’adapter très rapidement aux mesures proposées par l’exécutif, pour probablement sauver des situations qui auraient pu péricliter plus vite sans que les opportunités aient été saisies. Certains étaient déjà en grave difficultés et sans doute qu’il n’était pas idéal de rajouter de la dette à la dette. Mais dans la globalité, ces mesures ont sauvé un bon nombre d’entreprises. Maintenant qu’on a paré à l’urgence, il est tout de même regrettable de constater cette paralysie du système et le faible taux d’ouverture de procédures amiables. Car même si ces sociétés ont ajouté une ligne de PGE, même si elles ont décalé leurs charges, elles vont devoir restructurer globalement leur dette. J’ajoute qu’en ce moment, certaines mesures spécifiques permettent de mieux traiter ces difficultés, notamment dans le cadre d’une conciliation. Le plus vite sera le mieux. Pourquoi attendre d’être en face du mur pour réagir ? Lorsque les aides vont s’arrêter, il y aura un engorgement des dossiers et il deviendra plus compliqué de les faire traiter par les banques, les investisseurs, voire même par le tribunal. C’est pourquoi il est désormais urgent de s’attaquer au fond, même s’il faut reconnaître que la visibilité sur l’avenir demeure compliquée.
Aline Poncelet : L’importance d’écouter les signaux faibles c’est aussi de réagir le plus tôt possible pour garder le contrôle sur la restructuration nécessaire. La procédure de prepack, qui se termine par l’homologation dans le cadre d’une conciliation, permet aux dirigeants de faire rentrer des investisseurs pour renforcerles fonds propres et lever de la dette grâce au privilège de new money, tout en restant aux commandes. C’est une solution efficace et confidentielle, mais à condition d’avoir anticipé.
À cet égard, la reprise par le débiteur ou les dirigeants au stade suivant du redressement judiciaire dont on parle beaucoup actuellement n’a été facilitée par l’ordonnance Covid du 20 mai 2020 que jusqu’ au 31 décembre 2020. Il est loin d’être certain que cette solution – très sensible voire contestée – sera prorogée – avec ses garde fous – dans le cadre de la loi de transposition de la Directive Insolvency en préparation pour 2021. Si tel n’est pas le cas, l’anticipation via le prepack restera la meilleure approche…

[ Nicolas Yakoubowitch -« Les banques ont prêté, mais que va-t-il se passer dans les quatre prochains mois ? Devra-t-on rembourser tout ou partie, ou passer sur un amortissement dont on ne connaît même pas le coût financier pour le moment ? »
Numa Rengot : Toutes ces mesures se déroulent néanmoins sous l’égide du tribunal de commerce. Il faut donc faire beaucoup de pédagogie auprès de nos clients et auprès des investisseurs pour leur expliquer la procédure. D’une juridiction à l’autre, les dossiers peuvent être traités de façon bien différente. Or dans cette période, ce que j’appelle « l’amiable défensif » n’a pas toujours plus à certains administrateurs judiciaires qui considèrent avant tout la conciliation comme une mesure « consensuelle » d’accompagnement de la société. Mais en réalité, c’est bien de l’amiable défensif que l’on fait depuis la mise en place de l’urgence sanitaire. Dans le bureau du président du tribunal, lorsque l’avocat demande l’ouverture d’une procédure amiable, il défend son dossier et lui donne une coloration. Nous avons réussi à convaincre le tribunal de placer des entreprises en conciliation alors qu’elles étaient en état de cessation des paiements, mais compte tenu de la computation des délais à compter du décret et de la date d’état d’urgence sanitaire, une lecture assouplie des critères était possible. Et pour finir, les chefs d’entreprises ont réussi à sortir leur dossier. Les opportunités permises par le contexte étaient inédites.
Bien sûr d’autres problématiques vont survenir rapidement, notamment celle du PGE, avec cette petite musique chez certains laissant croire à une transformation en quasi-fonds propre.
Le revers de l’octroi des PGE
Noam Ankri : J’estime qu’il y a un certain nombre d’entreprises qui n’auraient pas dû bénéficier de ces aides financières, notamment du PGE, ou à tous le moins pas sans les accompagner de mesures de restructuration plus profondes. Certaines sociétés ont eu accès en effet à des PGE alors qu’elles allaient déjà très mal dès avant la crise. Elles n’ont ainsi fait qu’accroitre leur dette pour se retrouver de toute façon, dans six ou douze mois, devant l’inexorable. Régler les sujets court terme pour gagner quelques mois n’aide personne, à part peut-être l’actionnaire. Mais le sujet doit être de sauver l’entreprise et non l’actionnaire. Il faut parfois laisser faire le marché et ainsi restructurer les sociétés qui en ont besoin plutôt que d’y injecter des fonds trop souvent perdus d’avance. Le droit français est doté d’outils formidables de prévention, d’ailleurs la directive européenne s’en inspire, qui permettent à l’entreprise de changer de main, de trouver un investisseur plus adapté ou qui a envie de donner une nouvelle chance à l’entreprise.

[ Noam Ankri - « J’estime qu’il y a un certain nombre d’entreprises qui n’auraient pas dû bénéficier de ces aides financières, notamment du PGE, ou à tous le moins pas sans les accompagner de mesures
de restructuration plus profondes. »
Albert Szulman : Les banques ont été souvent attentives avec les start-up, même si les injonctions du gouvernement les incitait à signer des PGE dans tous les cas. L’octroi de certains PGE, et leur montant a pu souvent dépendre de la relation entre l’entrepreneur et sa banque. Rappelons que les établissements bancaires avaient également un rôle à jouer dans le contrôle financier et ils ont souvent questionné les business plans et les perspectives, afin a minima d’ajuster les PGE pour optimiser le risque encouru. Les start-ups sont aujourd’hui très endettées, avec des perspectives de revenus pas toujours claires, surtout que la crise n’est pas terminée.
Nicolas Yakoubowitch : Durant ces deux périodes de confinement, les banques ont joué le jeu mais en maintenant, en tout cas au départ, leurs critères de banquiers avec des ratios, des examens détaillés des comptes, des business plan. J’ai levé plus d’un million d’euros de PGE en rentrant directement en contact avec les banquiers, pour accélérer les processus de mes clients. Au fur et à mesure, les réseaux bancaires ont unifié leurs process pour gagner du temps et pour, parfois, verser les PGE en 48 heures lorsque l’entreprise n’avait pas de liquidité structurelle.
Certes, on a facilité l’endettement des entreprises pour payer de la perte. Demain, lorsque l’activité va repartir, l’entreprise devra réinvestir. Mais le banquier, là, risque de ne plus vouloir prêter. S’est-on tiré une balle dans le pied pour l’avenir ? C’est bien pour cela qu’a été institué le prêt rebond, avec les régions et Bpifrance, pour permettre un financement supplémentaire. Initialement, le PGE devait représenter 200 milliards d’euros. Les banques en ont distribué un peu plus de 100 milliards et souvent aux entreprises qui étaient en bonne santé financière avant la crise Covid. Les banques ont prêté, mais que va-t-il se passer dans les quatre prochains mois ? Devra-t-on rembourser tout ou partie, ou passer sur un amortissement dont on ne connaît même pas le coût financier pour le moment ?
Aline Poncelet : Les bénéficiaires des PGE sont à 80 % des TPE et PME et le montant moyen de l’enveloppe allouée va de 90 000 euros à 1 million d’euros selon qu’il s’agit de TPE ou de PME. Le reste de l’enveloppe des 100 milliards d’euros est revenu à une trentaine de grandes entreprises pour des montants très élevés dont, bien sûr, la presse parle beaucoup, mais surtout à plus d’un millier d’ETI avec un montant moyen de 12 millions d’euros. Il faut donc relativiser le poids de l’endettement. Cela étant dit, il est sain que le dirigeant se dise qu’il ne pourra pas rembourser car il doit faire de l’ingénierie financière dès à présent, pour encore une fois anticiper. Il peut ainsi se refinancer en renforçant ses capitaux propres, faire venir des investisseurs, se rapprocher par fusion d’un partenaire, émettre des actions de préférence « spéciales Covid », voire même avoir recours à la fiducie selon des schémas déjà développés en situation de pré-faillite. Donc d’une manière ou d’une autre, il faudra être créatifs pour transformer les PGE en capitaux propres ou ressources long terme.

[ Julien Zuccarelli - « La plupart du temps, les prêts sont octroyés si le dirigeant démontre qu’il est en train de se soigner et de conduire l’entreprise dans une trajectoire de profitabilité en travaillant ses fondamentaux, ses coûts fixes, etc. »
Albert Szulman : C’est une spirale infernale : l’entreprise endettée va consacrer une partie de ses ressources à la rembourser, sans avoir la capacité d’investir dans des projets de développement. Et d’un autre côté, les banques n’ouvriront plus les vannes du financement si facilement. Il est donc urgent de mener une réflexion sur l’avenir de cette dette qui a été créée dans l’urgence pour sauver l’économie. La France a été l’un des pays qui a réagi le plus vite pour sauver ses entreprises. Il faut maintenant transformer l’essai pour ne pas grever la croissance. Et pourquoi pas transformer la dette en equity sans intervention, directement par l’État ?
Noam Ankri : Je suis d’accord avec vous. L’injection de ces liquidités a sauvé énormément d’entreprises et fort heureusement. Nous pouvons nous féliciter du système d’aide adopté par la France qui a été l’un des plus rapides et efficaces en Europe selon moi. Mais je continue de croire qu’un euro injecté en dette, ou en fonds propres, dans une entreprise restructurée vaut dix fois plus qu’un euro injecté dans un groupe qui a un bilan malade. C’est pourquoi il faut trouver des solutions pour que ces aides soient accessibles dans le cadre d’une restructuration plus globale de l’entreprise. Nous disposons des outils et des procédures pour justement accompagner les chefs d’entreprise. Rappelons que les juges consulaires sont eux-mêmes des commerçants et donc connaissent les difficultés de ceux qui se présentent à leur porte. Mais les miracles ne sont possibles que si l’on se fait dépister tôt.
Julien Zuccarelli : Pour les deux entreprises que je dirige, nous avons levé deux PGE d’un millions d’euros et de huit millions. Or mon expérience a été loin d’être aussi facile que celle que vous décrivez. À la base, le PGE n’a pas été conçu pour aider les entreprises qui étaient en retournement, mais bien pour aider le déficit de trésorerie lié à la crise du Covid et au peu d’activité. Mais les acteurs se sont tous adaptés et ont insufflé une dose de pragmatisme dans la pratique.
La plupart du temps, les prêts sont octroyés si le dirigeant démontre qu’il est en train de se soigner et de conduire l’entreprise dans une trajectoire de profitabilité en travaillant ses fondamentaux, ses coûts fixes, etc. La France n’a certainement pas accentué les difficultés des entreprises avec les PGE, elle les a sauvés. Il va falloir rembourser, certes, mais nous pouvons être fiers de ce qui a été fait.
À quoi s’attendre dans les prochains mois ?
Charles Beigbeder : D’un point de vue financier, il me semble curieux qu’après plus de six mois, les entreprises n’aient pas encore commencé à renforcer leurs fonds propres. Le PGE était un bon mécanisme pour palier le choc, l’urgence, mais je suis étonné de la faiblesse des opérations de renfort de fonds propres… Où est cette fameuse poudre sèche du capital investissement français dont nous nous gargarisons ? Qu’attend-elle pour être investie ? Il va falloir que tout le monde se réveille pour faire des opérations et rapidement.
Aline Poncelet : Il existe 1 200 cibles qui sont dans la catégories grandes entreprises et ETI qui ont eu des PGE !
Albert Szulman : J’ajoute qu’à partir de l’année prochaine, nous allons avoir les premiers fonds VC qui vont arriver à expiration alors qu’ils soutiennent à bout de bras des centaines de start up. Je pense qu’il y aura aussi de la casse, et donc de belles opportunités pour les fonds intéressés, car un certain nombres d’entre elles ne seront plus financées.
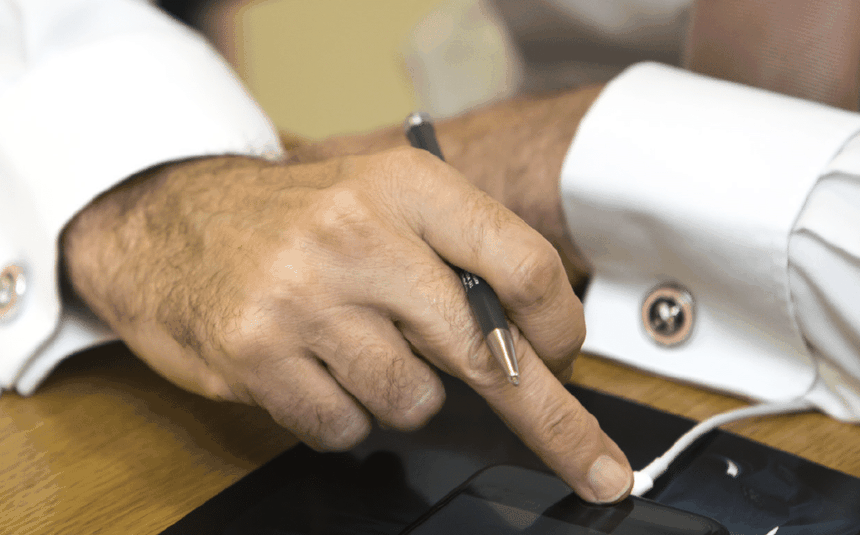
L’association Les Rebondisseurs Français est une communauté de 900 entrepreneurs convaincus que la valorisation du rebond est indispensable au succès et à l’épanouissement des créateurs d’entreprise.
Caroline Texier : Du point de vue juridique, la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité doit être transposée en droit français d’ici mai 2021. Les projets de lois de transposition sont déjà disponibles en Hollande et en Allemagne et les lois devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2021. La directive vise à accélérer le rythme des procédures, les limiter dans le temps et renforcer le pouvoir des créanciers. Elle prévoit en outre l’instauration de classes de créanciers. Aujourd’hui, dans les procédures collectives, les créanciers sont consultés en fonction de leur nature. Dans le cadre de la directive, on les consultera en prenant en compte la nature et la qualité de leur créance. Il va donc être possible de faire voter les créanciers par classe, et éventuellement d’imposer le plan à certaines classes de créanciers subordonnés, ceux qui ne sont plus dans la monnaie, voire aux actionnaires. Il faudra néanmoins veiller au principe essentiel « the best interest test », c’est à dire qu’il faudra s’assurer avant de pouvoir imposer quoi que ce soit à une classe de créancier qui aurait pu voter contre, qu’elle n’aurait pas été mieux traitée en liquidation.
Numa Rengot : Je ne crois pas à l’apport bénéfique de cette directive européenne pour mieux restructurer en droit français.
Caroline Texier : J’ai également quelques craintes.
Numa Rengot : Le droit français de l’insolvabilité est probablement l’un des plus poussé en Europe, peut être avec celui de l’Allemagne. Les rôles sont bien répartis entre les acteurs et nous avons une bonne visibilité sur les outils. S’agissant des classes de créanciers, la directive vise à améliorer le processus en imposant une solution à ceux qui n’en veulent pas. Cette directive ne sera pas indolore pour la France.
Caroline Texier : Je crains par ailleurs que ce texte complexifie et alourdisse le coût de la procédure. En outre, je me demande si la mise en place de ces classes de créanciers est adaptée à toutes les tailles d’entreprises.

[ Caroline Texier - « Pourquoi attendre d’être en face du mur pour réagir ? Lorsque les aides vont s’arrêter, il y aura un engorgement des dossiers et il deviendra plus compliqué de les faire traiter par les banques, les investisseurs, voire même par le tribunal. »
Noam Ankri : Certes nos procédures collectives sont des outils parfaitement huilés, techniques et très poussés. C’est d’ailleurs pourquoi, dans un contexte de Brexit, nous sommes de nombreux professionnels à pousser pour que la sauvegarde remplace le scheme of arrangement anglais que la plupart des sociétés européennes utilisent lorsqu’elles ont besoin de restructurer leur dette. Notre droit des faillites est efficace. Mais, très protecteur du débiteur, il comporte une anomalie du point de vue des étrangers, celle du droit de veto de l’actionnaire. Pour mener une restructuration financière efficace, qui passe souvent par une conversion de la dette en capital, l’actionnaire en droit français continue de devoir donner son accord préalable. Heureusement, la directive européenne devrait nous mener vers une approche plus anglo-saxonne, celle des classes de créanciers rangés en fonction de la nature de leur créance, pour éviter que l’actionnaire qui n’est plus dans la monnaie ait son mot à dire. Cette réforme devrait permettre un meilleur afflux de capitaux venant d’investisseurs étrangers qui considéreront avoir désormais une meilleure sécurité juridique. Mais à l’inverse, donner un peu moins de pouvoir à l’actionnaire et un peu plus aux créanciers comporte un risque que les débiteurs hésitent à aller voir le tribunal, et donc à se dépister tôt, par crainte de tomber dans l’escarcelle de leurs créanciers.
Aline Poncelet : En développant le privilège de new money à tous les stades de la procédure, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, je crains que ne se crée une bombe à retardement. Car parallèlement, rien ne permettra de renforcer les fonds propres, ce qui déséquilibrera davantage la structure bilancielle et accentuera un phénomène de fuite en avant. Nous savons aujourd’hui que le privilège de new money, dans le cadre des conciliations, a entrainé des financements à des prix très élevés et avec des garanties que même les juges disent disproportionnées. Ce sera le même phénomène avec le nouveau privilège postérieur. En cas de restructuration insuffisante ou trop dure, le second « round » risque d’être fatal. Il aurait donc fallu, au contraire, faciliter la conversion de la dette en capitaux propres ou simplement en fonds propres. En nous alignant sur les anglo-saxons, je ne suis pas sûre que nous allions dans le bon sens.







