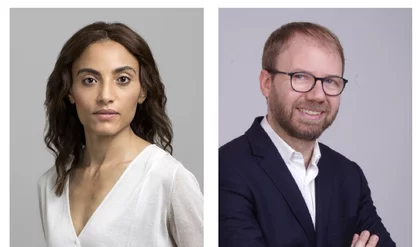Début février, Ceva Santé Animale a signé le plus gros LBO de l’histoire du private equity français d’une société contrôlée par ses managers. Le laboratoire vétérinaire girondin dirigé par Marc Prikazsky a ainsi tutoyé les cinq milliards d’euros de valorisation pour sa cinquième recomposition actionnariale depuis 1999. Un « jumbo deal » qui voit le management, composé de plus de 800 cadres actionnaires, conforter sa position majoritaire acquise dès le troisième LBO de 2007, et accueillir quatre nouveaux investisseurs : Téthys Invest, la holding d’investissement de la famille Bettencourt-Meyers, le fonds de pension canadien PSP Investments, le japonais Mitsui & Co, spécialisé dans le trading de matière première, et enfin le laboratoire pharmaceutique allemand Klocke Gruppe (cf. notre interview pages 6 à 9). Si Ceva Santé représente un cas d’école de prise de contrôle des managers grâce à l’effet relutif de deux décennies de LBO, de plus en plus d’exemples illustrent cette montée en puissance dans le paysage du private equity français.
"On ne peut pas faire du majoritaire avec une gouvernance de minoritaire ! " Florent Lauzet, associé de Siparex et responsable de l'activité ETI.
L’exception française
De fait, les managers ont aujourd’hui parfaitement conscience de leur importance dans la réussite d’un deal. Ils savent que pour apporter les transformations nécessaires à la création de la valeur et du TRI du fonds, ils doivent se démener et aller chercher la croissance avec les dents. La structuration d’un écosystème de conseils particulièrement aguerri et compétent a aussi participé à durcir les négociations et aligner les dirigeants sur les pratiques les plus exigeantes.
Ce changement de rapport de force est particulièrement avéré dans les opérations de grande taille où la concurrence autour de beaux actifs fait évoluer les management packages vers des pratiques inédites, creusant encore plus l’écart entre l’écosystème français et ceux des voisins européens bien moins « management-friendly ». Une exception tricolore qui tend à cumuler les effets sweet equity et « ratchet » à l’inverse des pratiques des pays voisins. Ainsi, aussi bien au Royaume-Uni qu’en Allemagne, la structuration des management packages se fait essentiellement à base de « sweet equity » avec un « hurdle » moyen proche des 10 %. Une structuration qui offre l’avantage de la simplicité et de la lisibilité mais qui peut engendrer un désalignement d’intérêts en cas de sous-performance du LBO. Cette structuration est loin de prédominer dans les pratiques hexagonales où le sweet equity est souvent combiné à des instruments relutifs payés à leur valeur de marché. L’introduction de ces instruments, essentiellement sous forme d’actions de préférence, permet par exemple de tenir compte du multiple réalisé sur l’investissement du fonds, afin que le partage de valeur à la sortie ne dépende pas que du TRI de l’opération. « On est très attentifs à ce que le seuil de déclenchement du management package soit adossé à des conditions non seulement de TRI mais aussi de multiple, explique un acteur du mid market. Car contrairement aux idées reçues qui veulent que les investisseurs soient toujours pressés de vendre, le manager peut parfois vouloir pousser à la sortie au bout de deux ou trois ans si les premières années de l’investissement sont très réussies et s’il n’est intéressé qu’au TRI, ce qui crée un désalignement d’intérêt avec le fonds. » D’ailleurs, l’accélération du taux de rotation des portefeuilles avec des LBO qui se dénouent en moins de trois ans témoigne d’une certaine fébrilité des dirigeants, soucieux d’entamer un nouveau cycle à des conditions plus favorables pour peu qu’ils aient surperformé la feuille de route initiale. « Les fonds ont tout intérêt à viser un alignement d’intérêt dans la maximisation de la valeur pour neutraliser l’effet inhibiteur d’un management package « capé » dans les dernières tranches de rétrocession », rappelle un banquier d’affaires spécialisé dans le conseil des dirigeants. Car quel sera l’intérêt pour le manager d’aller chercher les paliers de croissance en plus si le partage lui est moins favorable ? Autant les réserver pour le tour d’après et en faire bénéficier un sponsor plus généreux… Surtout dans le passage d’un LBO primaire à un secondaire, où le statut de l’équipe dirigeante change de dimension et de profil de risque. « On ne retrouve plus vraiment la décote sur les valorisations des opérations minoritaires, dont les conditions se sont alignées sur celles des deals majoritaires », souligne Florent Lauzet, associé de Siparex responsable de l’activité ETI. « En revanche, la ligne de démarcation reste très importante entre un deal primaire plus risqué et un LBO secondaire au process plus formaté et concurrentiel », poursuit l’investisseur mid market qui s’est fait une spécialité de dénicher les deals primaires.
Du majo avec une gouvernance de mino !
Pour les deals les plus âprement disputés, les équipes dirigeantes arrivent à la table des négociations avec des packages déjà ficelés et imposent leurs règles, pas seulement au niveau des taux de déclenchement de la rétrocession de la plus-value, mais aussi sur les conditions de « leavers » et des clauses de « drag along » pour garder la main sur le timing de sortie. Ces dernières clauses, autrefois prérogative absolue du sponsor majoritaire, sont en quelque sorte devenues la dernière carte à jouer pour séduire des managers soucieux de maîtriser le calendrier de sortie de leur actionnaire financier. Si la plupart des fonds n’ont plus de position de principe contre le fait de se faire racheter par le management (alors qu’à une époque c’était une option déshonorante), ils sont loin d’apprécier le systématisme de cette voie de sortie, qui peut parfois déboucher sur une impasse. « Il faut qu’il y ait un process pour objectiver la valeur, sinon c’est du portage ou de la mezzanine mais plus du LBO », s’insurge l’associé d’un fonds mid-cap.
Autre signe de la bascule des rapports de force en faveur des managers, la limitation dans certains cas de la marge de manœuvre des sponsors en termes de gouvernance. Exit le privilège jadis incontesté de l’actionnaire majoritaire de révoquer le président de l’entreprise sous LBO sans devoir le justifier. Il doit désormais s’appuyer sur des éléments tangibles de sous-performance pour étayer sa décision de confier les rênes de la société à un nouveau manager. Cette amputation du pouvoir des fonds majoritaires est très mal vécue par la plupart des acteurs de la place. « L’inversion de la charge de la preuve pour changer de dirigeant est une dérive de la protection du manager que certains conseils tentent d’imposer », s’indigne Florent Lauzet. « On ne peut pas faire du majoritaire avec une gouvernance de minoritaire ! » Et pourtant, il n’est plus rare qu’un sponsor accepte de céder des droits de veto ou de mettre en place des clauses dans le pacte qui sont très favorables aux managers, par exemple en matière de financement des build-ups. « C’est globalement un mauvais message délivré aux fonds. Démarrer ainsi une relation en tirant trop sur le management package aux côtés d’un investisseur n’est pas idéal, compte tenu des épreuves potentielles », prévient un dirigeant qui a connu le cycle de restructuring des LBO dans les années 2009 à 2013. Car malgré le contexte euphorique de ces dernières années et face à la crise sanitaire d'ampleur que nous vivons, le LBO reste une aventure risquée et un partenariat où le point d’équilibre entre les objectifs des managers, les attentes des fonds cédants et les visées des nouveaux entrants obéit à une équation complexe. D’autant que la démocratisation des management packages poussée dans les LBO secondaires et tertiaires conduit à embarquer de plus en plus de monde dans le navire, bien au-delà du premier cercle des « happy few » managers.
La crise du Coronavirus et ses impacts inévitables sur l’économie et les entreprises devraient sans aucun doute rebattre les cartes. Mais à l’avantage de qui ?
Par Houda El Boudrari